Suite à une discussion intéressante que j'ai eu avec un membre du forum sur la philosophie de l'esprit et mon désir de répondre sérieusement à la question de ce topic : https://m.jeuxvideo.com/forums/42-68-68393602-1-0-1-0-comment-repondre-a-ses-questions-existentielles.htm ![]() , j'ai essayé de former un tout des réflexions que j'ai pu construire, exposé en-dessous.
, j'ai essayé de former un tout des réflexions que j'ai pu construire, exposé en-dessous.
Je crée cependant un topic indépendant de la question initiale car j'estime que le message est trop long et aborde trop de choses par rapport à ce à quoi l'auteur voulait que son topic soit destiné.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Définitions brèves :
Ensemble : Collection d'entités définies et distinctes.
Totalité (ou Infinitude, ou Réalité) : Ce qui ne peut pas être fini par autre chose, qui n'existe par soi et que par soi et donc dont la seule propriété est son être. La Totalité est opposée à la modalité/la partie/la finitude, qui elle, peut être finie par autre chose et qui n'existe pas seulement par soi mais aussi par autre chose, ce à quoi elle est une modalité.
Épistémè : Ensemble des connaissances en tout genre et issues de toute faculté de l'esprit (conception du monde, sciences, philosophies…) propres à une conscience (pour ne pas répéter esprit).
Système : Ensemble d'éléments considérés dans leurs relations à l'intérieur d'un tout fonctionnant de manière unitaire.
Langage : Ensemble de signes, de symboles ((formels ou informels) et de règles qui permettent d'assembler des énoncés.
Incomplétude : État de ce qui n'est pas complet, de ce qui n'est pas achevé. Plus concrètement, pour l'esprit humain, l'indécidabilité de certains énoncés implicites contenus dans un système (en tant qu'on les conçoit, il est possible d'y construire un langage par lequel il est possible de former ces énoncés).
Paradoxalité (d'un système) : Intrinsèquement liée à l'incomplétude, la paradoxalité correspond à l'état paradoxal partiel qu'un système contient. Plus concrètement, pour l'esprit humain, à la paradoxalité de certains énoncés implicites contenus dans un système (en tant qu'on le conçoit, il est possible d'y construire un langage par lequel il est possible de former ces énoncés paradoxaux)
Préfixe "Méta" (Wikipedia) : Méta est un préfixe qui provient du grec μετά (meta) (après, au-delà de, avec). Il exprime tout à la fois la réflexion, le changement, la succession, le fait d'aller au-delà, à côté de, entre ou avec.
Autoréférence : Propriété d'un énoncé dont le contenu sémantique est en relation avec cet énoncé, et qui, par cela même, est susceptible d'engendrer une antinomie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Axiomes brefs :
I - L'axiome de la Totalité (la considération de la notion de Totalité d'une quelconque manière, explicitement ou implicitement) est indépassable par les facultés de l'esprit en tant qu'elles sont actuellement. C'est à dire qu'on ne peut considérer une activité des facultés de l'esprit (ou réflexion), sans faire appel d'une quelconque manière à cette présupposition.
II - En plus de l'obligation que pose l'axiome de la Totalité (par l'axiome I), les facultés de l'esprit humain sont contraintes, en tant qu'elles sont actuellement, quelque soit la réflexion qu'elles émanent, à toujours se "placer" épistémologiquement quelque part, c'est à dire à considérer des systèmes et les énoncés qu'on peut former à partir des langages qu'on peut construire à partir de ces mêmes systèmes (en tant qu'on les conçoit) comme plus "crédibles" ou plus précisément plus proches de la Totalité présupposée obligatoirement par l'axiome I, que d'autres énoncés issus d'autres systèmes (en tant qu'on les conçoit aussi) .
III - (Axiome d'extension des théorèmes d'incomplétude de Gödel : https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8mes_d%27incompl%C3%A9tude_de_G%C3%B6del )
- La présence d'axiome/présupposition/postulat/point de départ dans un système, en tant qu'il est conçu, augmente (ou du moins assure) l'incomplétude/paradoxalité partielle de ce dernier .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comment répondre à ces questions existentielles ?
(Question du topic à laquelle j'ai voulu répondre. Les termes sont un peu flous, mais le fond est plutôt clair. Je vais tenter d'y répondre par l'étude de la connaissance même, c'est à dire épistémologiquement.)
L'on peut penser plusieurs "réponses" à ces questions, même quand elles sont très bien posées.
Cela dit, certaines seront toujours considérées plus crédibles que d'autres selon chacun.
C'est à dire que, chez chaque personne, il y'a une idée profondément implicite et inextirpable de la Totalité (ou Réalité) en tant que Vérité Absolue et d'une hiérarchie "d'absoluité" (même si paradoxale) des systèmes (formels ou informels), c'est à dire de leur rapprochement (aux systèmes) à cette Totalité. (axiome I et II)
En effet, je pense qu'il nous est impossible de réfléchir sans supposer, même très implicitement, la notion de Totalité (axiome I), dont dérive le principe de non-contradiction dans une forme un peu plus imparfaite tel qu'il est formalisé. Ce n'est pas seulement le langage qui présuppose cela selon moi, mais carrément ce qui construit le langage, c'est à dire la cognition et/ou les facultés de l'esprit, d'une certaine manière.
On se place épistémologiquement (ce qui concerne toute forme de connaissance) toujours quelque part, de par notre finitude, ce qui nous pousse à considérer certains énoncés comme plus "crédibles" ou plus "vrais" que d'autres. (axiome II)
Même ceux qui refusent la Totalité comme concept, pensant s'en extirper, présupposent dans leur refus même la Totalité et une hiérarchie "d'absoluité", du fait qu'ils posent une impossibilité de conception de la Totalité qui est elle-même une tentative d'accéder à une conception de la Totalité en lui attribuant cette non-concevabilité, de plus qu'ils estiment qu'il est plus "crédible" et "raisonné" de faire cela (c'est à dire attribuer de par leur conception une propriété de non-concevabilité à la Totalité) que de considérer une possibilité (plus clairement une obligation) de conception de la Totalité, même bien imparfaite.
Autrement dit, ils établissent une relation d'hiérarchie de rapprochement avec leur conception de la Totalité en tant qu'elle possède la propriété de non-concevabilité, c'est à dire "d'absoluité" dans ce qu'ils ont conçu comme l'Absolu (ou la Totalité), hiérarchie entre le système qui associe la propriété de non-concevabilité et le système qui associe une obligation de conception de la Totalité, même imparfaite.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Néanmoins, cette idée même de hiérarchie "d'absoluité" peut mener à l'intérieur de nos systèmes, dans une tentative de description de cette idée, à des paradoxes (je montrerai plus bas pourquoi), c'est à dire que cette idée même est "paradoxale".
Certes elle l'est, mais c'est surtout qu'elle affirme implicitement dans son contenu qu'elle est incomplétude dans un système non-absolu et qu'une tentative de sa démonstration ou de son application dans un tel système va faire tendre à une structure paradoxale. Elle a une forme d'autoréférence (de même nature que celle du paradoxe de Russel (https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_Russell), c'est à dire propre à l'universalité), dans laquelle elle dit que dans le langage où elle a été construite (ici issu d'un système fini), elle aura elle aussi une absoluité qui n'est pas infinie.
Description de la paradoxalité à laquelle on peut aboutir :
---
Si je veux décrire une hiérarchie/comparaison d'absoluité entre des systèmes, je suis obligé de le faire dans un système (en l'occurrence un méta-système), or l'absoluité de ce méta-système ne peut être non-comprise dans cette hiérarchie/comparaison d'absoluité pour parler de système de hiérarchie/comparaison d'absoluité, or pour inclure cela, il faut construire un méta-méta-système plus grand qui lui aussi doit avoir une absoluité et ainsi de suite...
On obtient ainsi une boucle récursive parce que l'on veut décrire l'Absolu dans le non-Absolu ou aussi parce que l'on veut appliquer une forme d'autoréférence universelle à une entité qui n'est pas en soi, mais aussi en autre chose (un système fini), c'est à dire qui ne se suffit pas réellement à elle-même.
---
Je pense que l'apparition de ces structures paradoxales de par l'autoréférence "universelle" est intrinsèquement liée au fait qu'on ne peut échapper épistémologiquement à l'axiome de la Totalité comme je l'ai énoncé dans l'axiome I couplé au fait que la présence d'axiome dans un système augmente (ou du moins assure) l'incomplétude/paradoxalité partielle de ce dernier (axiome III).
C'est pourquoi ces mécanismes tels que l'autoréférence menant à des structures paradoxales ne sont selon moi pas à ignorer, au contraire, car ils sont un signe de notre faiblesse épistémologique face à l'Absolu et donc possiblement d'un surpassement de cette dernière.
C'est donc selon moi ironiquement la paradoxalité à laquelle la considération d'une d'absoluité mène qui fait sa force, dans la considération d'une Totalité nous dépassant (en tant que facultés de l'esprit) et donc de notre finitude épistémologique fondamentale.
D'ailleurs, si la considération d'une absoluité pour un système ne menait pas à une structure paradoxale, elle mettrait à mal l'axiome III, car elle serait cohérente dans un système fini doté d'axiome/de postulat/de présupposition/de point de départ, alors qu'elle a prétention de saisir l'Absolu et d'user d'une autoréférence universelle.
C'est donc bien une généreuse chose, par rapport à ce que l'on a construit précédemment, que l'idée d'absoluité soit "paradoxale", ou mène à des structures paradoxales.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalement, cette hiérarchie "d'absoluité" qui s'impose comme une obligation à l'esprit laisse glisser la possibilité de progression de l'esprit comme un mouvement perpétuel de système en système. Cette possibilité ne correspond cependant qu'à une possibilité de progression, mais ne dit rien sur l'atteignabilité de la Totalité dans toute son infinitude.
Pragmatiquement, je ne pense pas que cette Totalité sera atteinte un jour par l'humanité, car, pour atteindre la Totalité qui est la même chose que la Réalité, la Réalité ne se démontrant totalement qu'elle même (par sa définition de ce qui n'existe qu'en soi et pas en autre chose ou autrement dit de son autosuffisance ontologique ; cela peut être aussi discuté plus rigoureusement par des formes de démonstrations malgré que pouvant êtres considérées comme imparfaites : https://m.jeuxvideo.com/forums/message/1137971614 (à lire avant si vous voulez comprendre le post linké précédemment, une tentative de définition rigoureuse et très formelle de la vérité : https://www.jeuxvideo.com.com/forums/message/1122166332 )), il faudrait tout simplement devenir la Réalité, où il ne fait plus trop de sens de toujours parler d'humanité en tant qu'elle est conçue dans l'Occident (les agents que sont les humains et leurs interactions internes correspondant à la société (assez différemment de la conception de l'humanité chez plusieurs Indiens par exemple, où cette dernière est considérée comme tout ce avec quoi l'homme interagit, d'une quelconque manière)).
Ainsi nous pouvons converger (comme faire le contraire) en tant que sujets en mouvement petit à petit vers la Totalité, vers le saisissement de l'essence de tout ce qui fait l'objet, en tant qu'il est chose infiniment complexe de la Réalité (ou plus simplement de toute sa réalité), telle une suite qui peut ne jamais parvenir à sa limite mais qui s'en approche toujours tant qu'elle avance (et seulement tant qu'elle avance, car si elle recule, c'est l'inverse qui se produit).
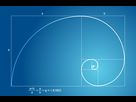
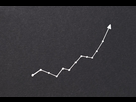
Réfléchir et accumuler du savoir, encore et encore... voilà une solution qu'on peut donner.
Penser atteindre un semblant de vérité objective dans un système (formel ou informel), puis faire face à l'incomplétude et la paradoxalité qu'il contient, puis dégager un nouveau système telle une unité dans la dualité que forme le système et son incomplétude/paradoxalité, puis répéter le processus indéfiniment.
Cela dit, ce même processus ne doit pas être employé n'importe comment pour penser avoir un semblant de progression, car il est très difficile de faire face à la paradoxalité et l'incomplétude, ne serait-ce que dans leur détection non-biaisée, mais aussi et surtout de dégager une unité (pertinente et indéformée par diverses lacunes logiques) de la dualité que forment un système et son incomplétude/paradoxalité.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bon...
Merci d'avoir lu (si c'est le cas). ![]()
Navré si ça a été quelque peu syntaxiquement imbuvable pour certains. 




